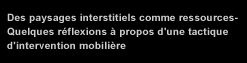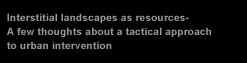Des paysages interstitiels comme ressources [1]
Quelques réflexions à propos d’une tactique d’intervention mobilière.
Luc Lévesque
Le paysage est avant tout une construction culturelle du regard issue de notre interaction sensible avec l’environnement. Réduire le paysage à une modalité idéalisée de la nature ou du patrimoine bâti, c’est oublier que son histoire a été celle d’une colonisation progressive des confins les plus inhospitaliers : forêts, montagnes, mers et déserts n’ont pas été toujours considérés comme paysages. Aujourd’hui, les véritables territoires à explorer ne sont-ils pas ceux que l’on ne voit plus à force d’y être immergé : ces contrées extensives et aléatoires de l’urbain ? Au moment où on ne sait plus très bien comment saisir les phénomènes d’urbanisation qui bouleversent la condition des villes contemporaines, le paysage peut constituer un mode d’exploration privilégié pour apprivoiser les transformations en cours si on ne le limite pas à des images préconçues [2] . Ce sont entre autres les différentes explorations esthétiques contemporaines qui en apprivoisant « le chaos » du monde urbain maintiennent ouverte la médiation paysagère, libérant du même coup de nouveaux points de vue sur la ville et des manières différentes de la vivre. Aborder ainsi le paysage comme laboratoire, tend notamment à remettre en question la primauté de l’objet architectural au profit d’un élargissement des registres d’interventions plus compatible avec la complexité de l’écoumène urbain.
C’est dans cette optique que les paysages interstitiels nous intéressent. Le propre de l’interstitiel est étymologiquement de « se trouver entre » les choses. Se référant à la notion d’intervalle, il renvoie de même à un « espace de temps ». L’interstice a rapport à la porosité. Le pore est cavité et passage, lieu propice au développement de processus qui échappent au contrôle et contaminent l’ordre statique de la représentation. Communément utilisé dans ce sens en sociologie urbaine pour désigner des lieux d’altérité et de pratiques informelles [3] , l’interstice peut être défini, d’un point de vue urbanistique, comme un espace sans affectation précise, immiscé pour une période indéterminée entre des configurations fonctionnellement déterminées. À la fois fait urbain concret et vecteur théorique, l’interstitiel s’associe donc à un ensemble conceptuel varié qui appelle, en cette période charnière, à penser différemment les modalités architecturales et paysagères du projet urbain [4] .
Cette géographie interstitielle de la ville peut aussi être envisagée comme points de résurgence potentielle du sauvage. Si le paysage ne se réduit pas aux éléments naturels, si l’interstitiel ne se réduit pas au résiduel, le monde sauvage, dans le même sens, ne se résume plus à l’entité lointaine et menaçante par rapport à laquelle la cité faisait jadis rempart. À l’inverse, la nature sauvage d’autrefois serait passée depuis longtemps du statut de menaçante à celui de menacée. Un autre type de sauvagerie plus ambiguë tendrait donc aujourd’hui à réémerger, suivant de nouvelles modalités, au cœur même des agglomérations métropolitaines. Au confluent de la brutalité moderne (infrastructures industrielles et commerciales, emprises routières et autoroutières, tabula rasa immobilière, etc.), de la colonisation rudérale (flore et faune) et de l’urbanité (appropriations collectives, pratiques conviviales et vernaculaires, etc.), la sauvagerie urbaine [5] nous confronte à des environnements bruts incarnant les contradictions troublantes que nos sociétés tendraient ailleurs à réprimer ou à masquer. Au moment où la virtualisation de nos rapports au monde s’accentue, la condition interstitielle nous offre notamment la possibilité d’apprendre au contact de la réalité sans fard qu’incarne cette impure et paradoxale sauvagerie.
Suivant cette perspective on peut considérer les paysages interstitiels de la ville à la fois comme des ressources à expérimenter pour ce qu’ils offrent et comme des milieux favorables à l’expérimentation. Cette observation appelle notamment des approches d’intervention qui ne chercheraient plus nécessairement à imposer un ordre englobant, mais qui viseraient plutôt à infléchir les dynamiques en présence avec un tact proche de celui de l’acupuncture. La ponctuation mobilière constitue un exemple de tactique d’intervention s’inscrivant dans cette voie [6] .
Le projet Hypothèses d’amarrages initié en 2001 à Montréal par SYN- explore concrètement ce cadre conceptuel. Partant du constat qu’un très grand nombre de résidus spatiaux sont produits et abandonnés par l’urbanisation contemporaine, qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas voués à être développés dans un avenir proche et qu’une bonne part de ces sites recèlent des qualités spatiales et paysagères propices à une occupation temporaire, le premier volet du projet Hypothèses d’amarrages propose l’implantation impromptue d’une vingtaine de tables à pique-nique sur une constellation choisie de sites résiduels de la région métropolitaine de Montréal. Privés ou publics, ces sites sont de natures diverses : friches industrielles, lots vacants, résidus autoroutiers, espaces verts, etc. Il s’agit là d’exploiter pragmatiquement les potentiels d’espaces oubliés, banalisés ou sous-utilisés pour offrir aux citadins de nouvelles connections à leur environnement. Des vingt tables installées sans autorisation à l’été 2001, plus de la moitié sont toujours, près de deux ans après, sur leur site d’origine; celles qui ont disparues étant fort probablement utilisées en d’autres lieux.
Le mobilier a été maintes fois employé en art comme thème d’explorations plastiques minimalistes ou pour « symboliser » dans la ville le rapport social ou la convivialité. Hypothèses d’amarrages ne s’inscrit pas dans cette veine. Une table à pique-nique reste une table à pique-nique : une pièce de mobilier générique offerte à une gamme variée d’appropriations et d’attitudes. S’il y a symbole, il est à lier au caractère générique de cette table qui incarne en usages sa propre iconicité in situ. Une table à pique nique peut servir à plein de choses. La socialité peut être l’une d’entre elles. La table à pique nique ne représente pas l’urbanité, elle s’inscrit dans la réalité urbaine comme une prise possible sur celle-ci. Dans plusieurs sites, des micro-communautés sont déjà là, la table ne vient que les confirmer et leur servir de support. Dans d’autres cas, la table peut constituer une incitation discrète à fréquenter des espaces qui « paraissaient » infréquentables mais qui recèlent en fait d’heureuses surprises. Sur d’autres sites encore, la table perturbe la vacuité et l’hygiénisme cosmétique de l’espace vert. Il ne s’agit que de faciliter l’habitation légère de sites constituant des potentiels négligés du substrat urbain. Comment habiter ces pores sans les obturer ? Comment ménager de l’espacement sans aménager?
Ce qui nous intéresse plus spécifiquement à propos du mobilier ce n’est pas tant la sophistication relative de son design, mais sa capacité de générer par un positionnement tactique, un champ d’interrelations et de situations pouvant enrichir l’urbanité. Le mobilier constitue en ce sens un véhicule pertinent pour catalyser de nouveaux rapports au paysage urbain, apprivoiser l’interstitiel sans en éradiquer la spécificité et inciter les citadins à « habiter l’inhabituel » [7] qu’ils côtoient quotidiennement. La table à pique nique, comme support d’occupation ouvert et nomade s’inscrit tout à fait dans cette perspective. Du relationnel peut en émerger, mais aussi, bien d’autres petites choses concrètes qui alimentent la vie urbaine. Ce sont des points de vue inusités sur la ville, d’autres temporalités à vivre, des possibilités de s’arrêter pour apprivoiser un espace et peut-être le voir autrement, des expériences sensibles et des attitudes différentes, des occasions de profiter de la réalité urbaine à l’écart du spectaculaire programmé ou de la représentation préconçue, etc.
L’avantage de l’intervention discrète sur sa contrepartie spectaculaire c’est qu’elle est notamment susceptible de durer par delà les contraintes de l’appareillage réglementaire et programmatif. En ce sens, les tables à pique nique d’Hypothèses d’amarrages constituent des sondes qui témoignent de l’espacement et du jeu qu’il est possible de trouver et d’exploiter à même le système spatio-temporel de la ville existante. Elles forment un réseau mouvant qui infiltre la cité par ses interstices, explorant une perspective alternative sur le traitement de l’espace urbain dans un contexte d’incertitude et de transformation. Ces « hypothèses d’amarrages » ne se visitent pas, elles se vivent et se vérifient en toutes sortes de petits moments qui échappent le plus souvent à l’archivage. Enfin, elles tablent sur un champ opératoire du concept de paysage qui tend souvent à être oublié : l’idée qu’une intervention peut et devrait dans bien des cas se limiter à presque rien, que l’existant recèle des potentialités pouvant être rendues visibles ou accessibles par des gestes discrets, presque immatériels.
Luc Lévesque, 2001-2003
[1] Ce texte a fait partie de notre contribution au XIXe Congrès de l’Union Internationale des Architectes (UIA), Berlin, 2002.
[2] Voir : Luc Lévesque, « Hyperpaysages : à l’affut de territoires réticulaires et mentaux », in CV photo, no 54, Montréal, 2001, p. 5-6.
[3] Voir : Frederick M. Trasher, The Gang. A study of 1313 gangs in Chicago, Chicago and London, The University of Chicago Press (1927), abridged edition 1963, p.20 ; Jean Remy et Liane Voyé, Ville, ordre et violence, Paris, PUF, 1981, p. 71; Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Paris, Les presses du réel, 1998, p. 14-16.
[4] Voir : Mirko Zardini, « The prevalence of landscape », in Nuevos paisajes/ New landscapes, Barcelone, Museu d’art Contemporani, ACTAR, juillet 1997, p. 203-209.
[5] Peter G. Rowe a utilisé le terme « urban wilderness » en l’associant à la face démoniaque, chaotique et babélienne de la vie urbaine contemporaine (Peter G. Rowe, Making a middle landscape, Cambridge, Londres, MIT Press, 1991, p. 244-247). Stigmatiser ainsi ce qui n’apparaît pas s’intégrer à l’image d’un ordre idéalisé nous paraît constituer une approche dangereusement réductrice. Et si l’urbanité trouvait dans Babel un terreau plus fertile que dans les décors vertueux supposés la servir? En proposant la notion de sauvagerie urbaine, il ne s’agit pas ici , pour nous, de faire l’apologie du désordre ou de la désolation, mais de s’attarder aux potentiels constructifs et critiques que cette condition est susceptible d’incarner par delà les stéréotypes cosmétiques et hygiénistes. Voir : Luc Lévesque, « Sauvagerie urbaine et jardins; quelques hypothèses », in Art et jardins. Nature / Culture, Musée d’art contemporain de Montréal, Montréal, 2000, p.129-140.
[6] Voir : Luc Lévesque, « Montréal, L’informe urbanité des terrains vagues. Pour une gestion créatrice du mobilier urbain », Les Annales de la recherche urbaine, no 85, Paris, p. 47-57. À propos de la notion de « tactique », voir : Michel de Certeau, L’invention du quotidien (Arts de faire I), Paris, Union Générale d’Éditions, 1980, I, chap. 3, p.19-23/ 82-94. Sanford Kwinter, Architectures of Time, MIT Press, 2001, p.122-123.
[7] Paul Virilio, L’insécurité du territoire, Paris, Stock, 1976, p.199-208.